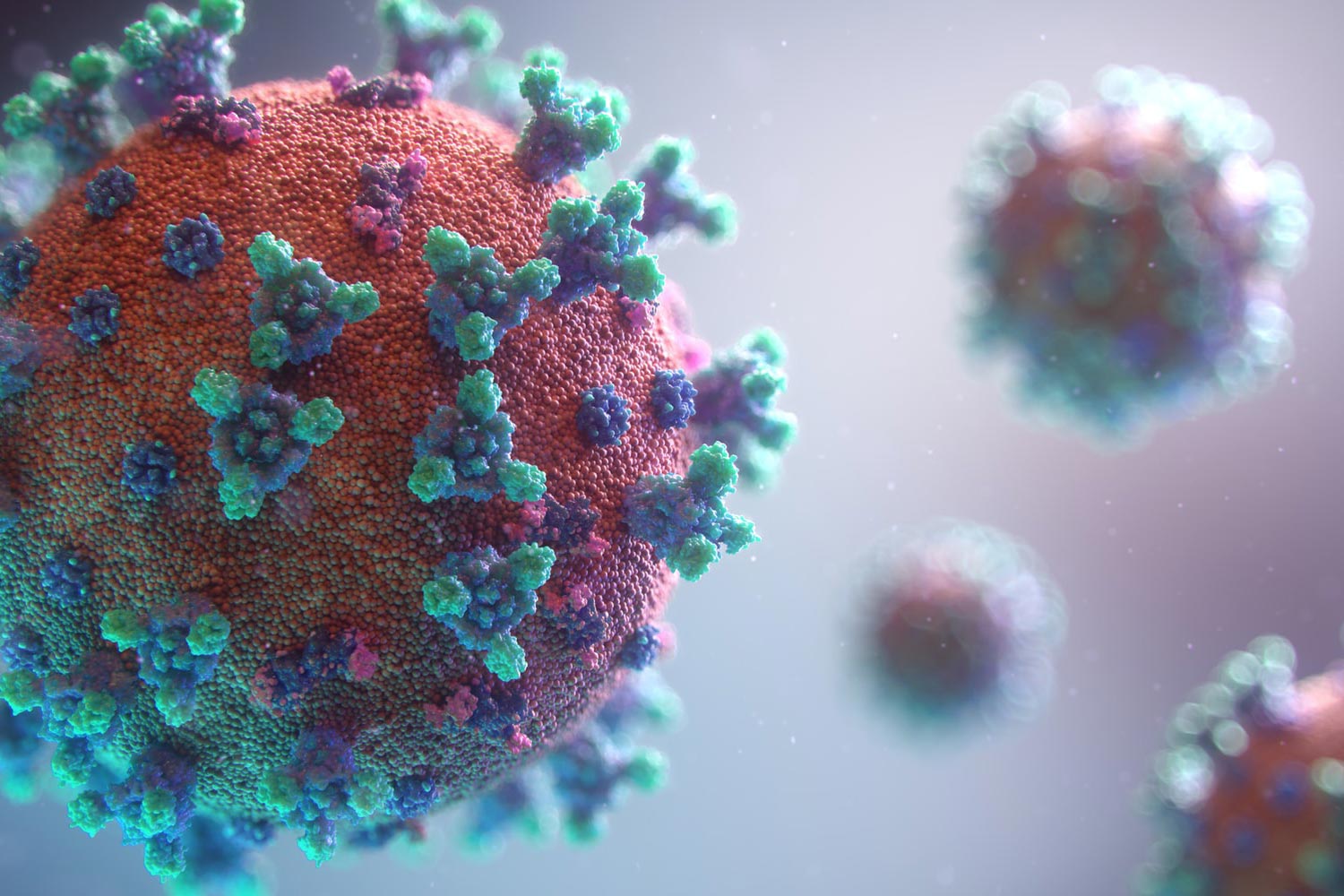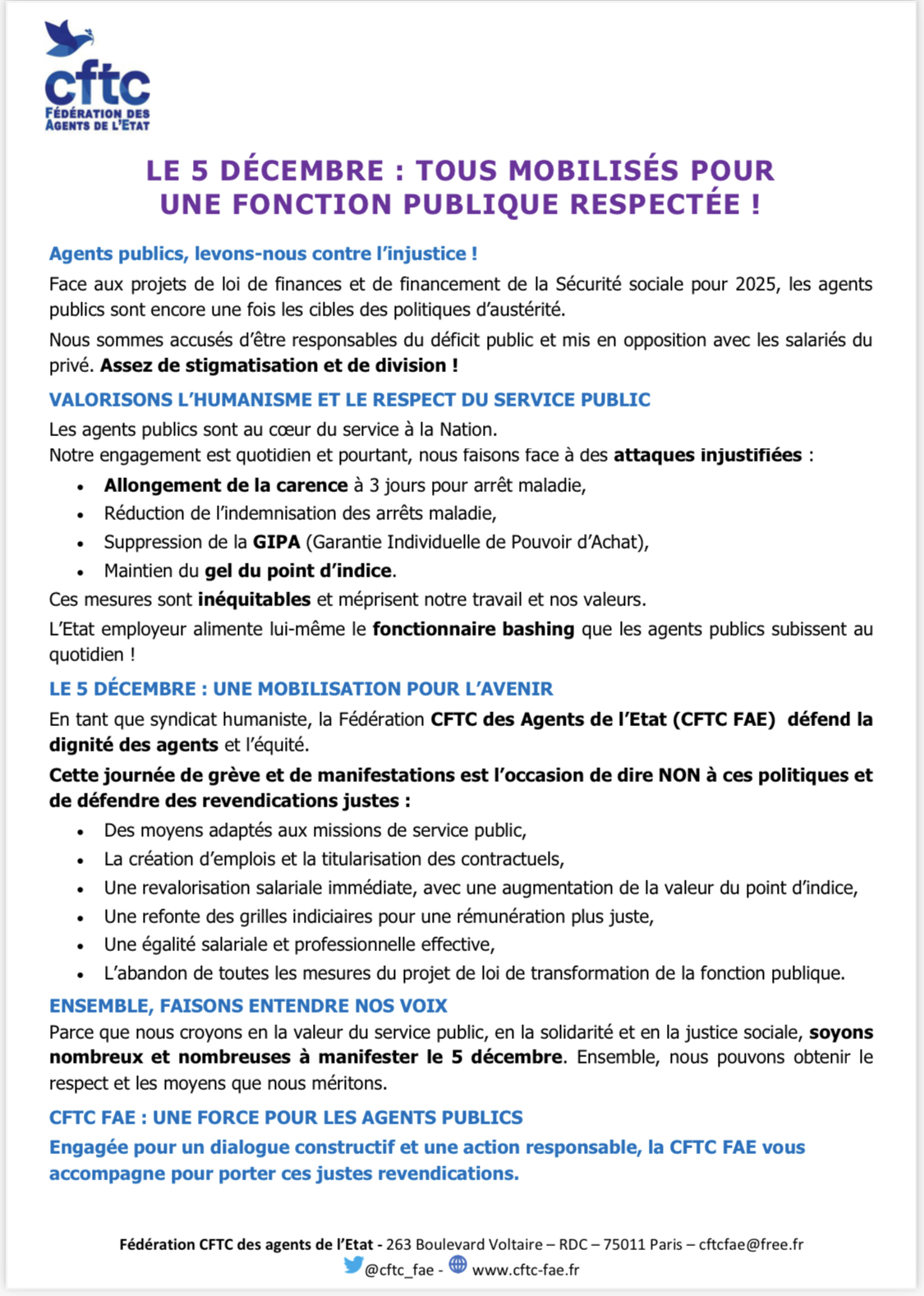LE PRINCIPE D’EGALITE DE TRAITEMENT N’INTERDIT PAS QU’UNE PRIME SOIT MOINS FAVORABLE POUR LES CADRES
La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2013, a jugé à propos d’une convention collective instaurant une prime moins avantageuse pour les cadres que « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation juridique identique […], cette différence devant reposer sur des raisons objectives […] et pertinentes. »
Mais selon la Cour, cette différence de traitement peut être justifiée entre cadres et non cadres si son objet est de prendre en compte les spécificités de situation de chaque catégorie de salariés comme les conditions d’exercice des fonctions, l’évolution de carrière ou les modalités de rémunération. Si ces conditions sont remplies, la convention collective peut donc prévoir un mode d’attribution d’une prime plus avantageux pour les non cadres que pour les cadres.
En l’espèce, un salarié cadre demandait un rappel de salaire au titre d’une prime liée à l’expérience professionnelle dont les taux et la durée variaient en fonction des différentes catégories socioprofessionnelles. Les cadres étant défavorisés, sa demande s’appuie sur le principe d’égalité de traitement. La Cour d’appel de Bordeaux, qui avait rejeté la demande du salarié, voit son arrêt censuré pour ne pas avoir recherché concrètement quelles étaient les spécificités ou les contraintes propres aux fonctions des non cadres qui justifieraient, au regard de la prime, un régime plus avantageux. Partant, dès lors qu’elle est suffisamment justifiée par les spécificités ou contraintes propres aux fonctions de chacun, cette différence de traitement est licite.
Pour la CFTC Cadres, la justification des exceptions au principe d’égalité de traitement est très importante. Elle permet en effet de mettre en valeur les spécificités du statut cadre et justifie donc intrinsèquement cette catégorie socioprofessionnelle. La CFTC Cadres vous invite à être très vigilant dans la conclusion de vos accords collectifs en ce qui concerne la pertinence des différences de traitement choisies.
Soc, 27 novembre 2013 n°12-20.246
UN SALARIE NE PEUT ETRE SANCTIONNE DEUX FOIS POUR LES MEMES FAITS
En l’espèce, un salarié avait subi une mise à pied disciplinaire de trois jours. L’employeur s’était rétracté par la suite en annulant unilatéralement la sanction, afin d’entamer à la place une procédure de licenciement pour faute grave, privatif de toutes indemnités.
Le salarié a alors saisi le conseil de prud’hommes en soutenant que l’employeur, du fait de l’annulation de la procédure disciplinaire, avait renoncé à se prévaloir de sa faute. Il conteste donc le bienfondé du licenciement.
Pour la Cour de cassation, « l’employeur épuise son pouvoir disciplinaire par la notification de la sanction et ne peut, relativement aux faits sanctionnés, le restaurer en décidant unilatéralement d’annuler la mesure ainsi notifiée ». Il en résulte que l’employeur avait donc déjà sanctionné le salarié, et qu’il ne pouvait le sanctionner une nouvelle fois que pour des faits nouveaux.
La plus haute juridiction fait ici une application stricte du principe de droit pénal non bis in idem transposé depuis 1982 au droit disciplinaire en entreprise. Selon ce principe, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. En prononçant la première sanction, et en dépit de son annulation, l’employeur est considéré comme ayant épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut plus invoquer la faute déjà sanctionnée que pour souligner la persistance d’un comportement fautif, ou pour caractériser la récidive.
Plusieurs décisions illustraient déjà ce principe selon lequel le prononcé d’une première sanction suffit pour que l’employeur épuise son pouvoir disciplinaire. Ainsi, lorsqu’un avertissement est prononcé, le licenciement ultérieur pour les mêmes faits ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, même si l’avertissement est annulé1 ou si la sanction initialement prononcée n’a pas été suivie d’effet.
Soc, 14 novembre 2013, n° 12-21.495
PORTABILITE DE LA COUVERTURE SANTE ET PREVOYANCE : DEVOIR D’INFORMATION DE L’EMPLOYEUR, DE LA CONCLUSION DU CONTRAT A SA RUPTURE
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 – signé par la CFTC – instaure un mécanisme de « portabilité » permettant au salarié de conserver le bénéfice des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées par
son ancienne entreprise en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.
A ce titre, l’employeur qui a souscrit à un régime de prévoyance pour ses salariés est titulaire d’une obligation d’information et de conseil et doit donc leur faire connaître de façon très précise les droits et obligations qui sont les leurs (art. L. 932-6 CSS
et ANI du 11 janvier 2008).
Par conséquent, c’est logiquement que la Cour de cassation considère qu’un salarié licencié qui n’a pas reçu d’information de son employeur sur la portabilité de la couverture santé et prévoyance de l’entreprise peut demander des dommages-intérêts. Débiteur envers le salarié d’un devoir d’information et de conseil,
l’employeur est également responsable des conséquences d’un défaut d’information ou d’une information inexacte (par exemple sur la nature ou l’étendue de la couverture sociale).
La portabilité des droits à la couverture complémentaire santé et prévoyance était une revendication portée par la CFTC lors de la signature de l’ANI en 2008. La CFTC Cadres se félicite donc de cette décision qui va dans le sens d’une plus grande sécurisation des parcours professionnels, en prévoyant l’attachement des droits à la personne et non plus au contrat de travail afin de permettre au salarié qui perd son emploi, de garder le bénéfice de sa complémentaire santé.
Soc. 20 novembre 2013, n° 12-21.999
AFFAIRE BABY LOUP : LA COUR D’APPEL FAIT DE LA RESISTANCE
La Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a finalement validé le licenciement pour faute grave de la salariée de la crèche Baby-Loup qui continuait à se présenter voilée au sein de la crèche. Cette solution prend le contre pied de celle rendue par la Cour de cassation le 19 juin dernier qui énonçait que « le principe
de laïcité […] n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public ».
Pour contourner cet obstacle, la Cour d’appel de Paris tient compte de la spécificité de l’activité de la crèche et s’appuie sur le caractère d’entreprise de tendance laïque, qualifiée « d’entreprise de conviction ». Elle considère qu’ « une personne morale de droit privé, qui assure une mission d’intérêt général, peut dans certaines circonstances constituer une entreprise de conviction et se doter d’un règlement intérieur
prévoyant une obligation de neutralité du personnel dans l’exercice de ses tâches ». En découle l’interdiction de porter tout signe religieux ostentatoire lors des activités d’éveil et d’accompagnement des enfants à l’intérieur et à l’extérieur des locaux professionnels.
Cet arrêt de « rébellion » laisse présager des nouvelles suites judiciaires à la saga Baby-Loup. Un nouveau pourvoi en cassation a d’ores et déjà été déposé par l’avocat de la salariée et aboutira même éventuellement à une saisine de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme. Cette affaire débutée en 2008 est donc loin de connaître son terme.